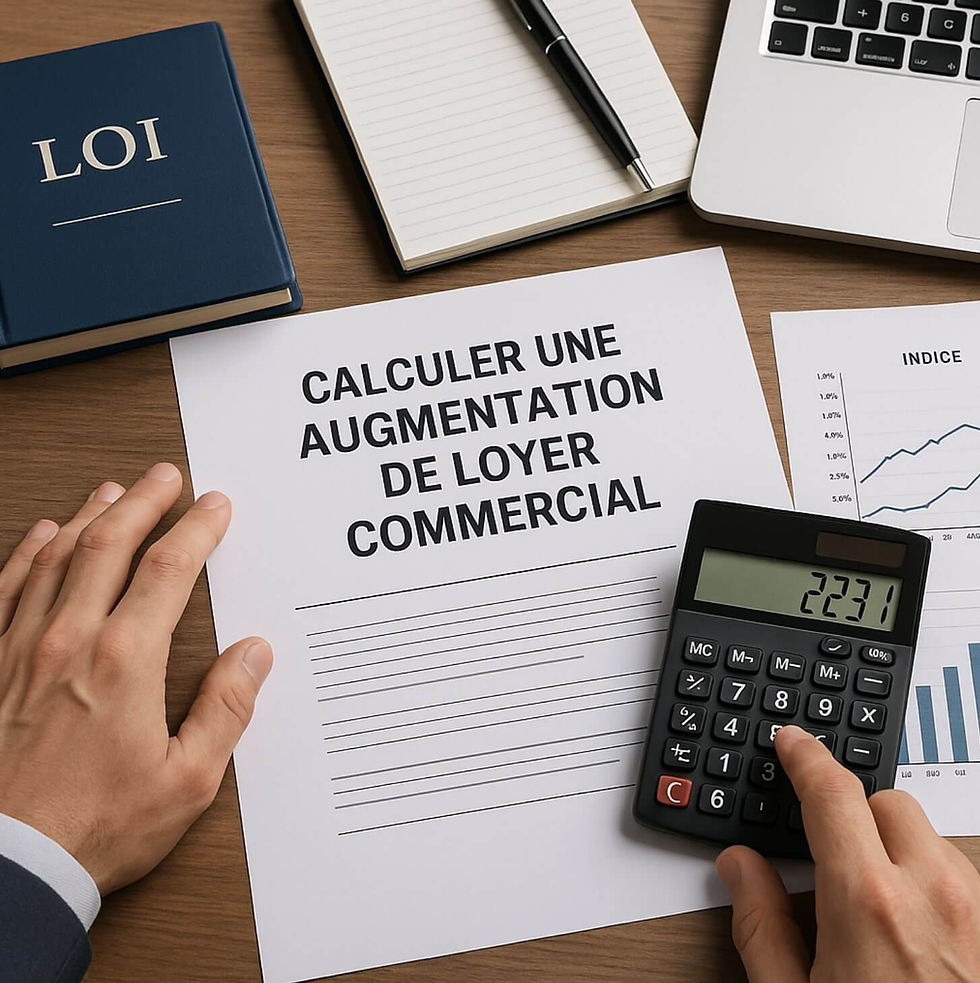Obligation de sécurité de l’employeur : respecter les préconisations du médecin du travail chez les clients
- Le Bouard Avocats

- 16 juil.
- 5 min de lecture
Vérifier, adapter et sécuriser les lieux de mission chez le client : les cinq obligations incontournables de l'employeur
Contrôler préventivement chaque site externe : assurez-vous que l’équipement exigé par le médecin du travail (transpalette électrique, aide au port de charge, etc.) est effectivement disponible avant toute affectation.
Intégrer les préconisations médicales dans vos contrats commerciaux : imposez par écrit à l’entreprise cliente l’obligation de maintenir les aménagements nécessaires à la santé du salarié.
Tracer toutes vos diligences : conservez rapports d’audit, échanges avec le service de santé au travail et preuves photographiques pour démontrer la conformité en cas de litige.
Réagir sans délai en cas de non-conformité : suspendre la mission, redéployer les effectifs ou fournir un équipement mobile afin d’éviter toute aggravation de l’état de santé du salarié.
Actualiser le DUERP et former le management : mettez à jour l’évaluation des risques et formez vos responsables de terrain à arrêter une intervention dès qu’un site client ne respecte plus les préconisations médicales.

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 juin 2025 (n° 24-13.083) marque une évolution décisive : désormais, l’employeur doit s’assurer que les lieux où ses salariés interviennent, même lorsqu’il s’agit d’entreprises clientes, permettent le respect intégral des préconisations du médecin du travail.
Cette décision impose un niveau d’exigence inédit aux directions générales, aux services RH et, par ricochet, aux salariés concernés.
Origine juridique de l’obligation de sécurité sur son lieu de travail
Un principe à ancrage législatif
L’obligation de sécurité, codifiée à l’article L 4121-1 du Code du travail, oblige l’employeur à « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Les articles L 4624-3 et L 4624-6 précisent que les propositions d’aménagements ou d’adaptations formulées par le médecin du travail doivent être prises en considération ; en cas de refus, l’employeur doit motiver sa décision par écrit.
Les textes applicables en pratique
Article L 4121-2 : hiérarchise les mesures de prévention (supprimer le risque, le réduire, informer les travailleurs).
Article L 4624-3 : habilite le médecin du travail à proposer des aménagements individualisés.
Article L 4624-6 : met à la charge de l’employeur la mise en œuvre ou la contestation motivée de ces propositions.
À retenir : le médecin n’émet pas de simples recommandations ; ses préconisations s’imposent au même titre qu’une prescription légale.
Enseignements clés de l’arrêt du 11 juin 2025 sur la sécurité au travail
Les faits rappelés en quelques lignes
Un conducteur routier, déclaré apte « sans port de charges > 10 kg et uniquement à l’aide d’un chariot électrique », effectue des livraisons dans sept magasins ; six d’entre eux ne disposent pas du matériel requis.
Après un arrêt de travail, il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat ; la cour d’appel le déboute, estimant que l’employeur ignorait la situation et que le salarié aurait dû l’alerter.
La position de la Cour de cassation
Responsabilité intégrale : l’employeur reste débiteur de l’obligation de sécurité, même lorsque le travail s’exécute chez un tiers.
Vérification proactive : il doit contrôler l’adéquation des lieux avec les préconisations médicales avant d’y envoyer le salarié.
Absence de renversement de charge : le salarié n’a pas à signaler les lacunes ; l’initiative appartient à l’employeur.
Portée jurisprudentielle
La haute juridiction rappelle qu’en cas de manquement :
la faute de l’employeur peut priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude ;
le salarié peut obtenir des dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Conséquences pratiques pour les chefs d’entreprise et les DRH sur la sécurité au travail
Vérifier les sites clients avant toute affectation
Audit systématique des lieux de travail : établir un protocole de vérification (matériel, organisation du travail, équipements de protection).
Clause contractuelle : insérer dans les contrats commerciaux une obligation pour le client de maintenir les aménagements exigés.
Visite préalable : faire intervenir le service HSE ou le médecin du travail sur site, lorsque la mission présente un risque particulier.
Documenter le suivi des préconisations
Tenir un registre des visites et des échanges avec chaque client.
Archiver les attestations de conformité (photos, fiches techniques, protocoles de sécurité).
Mettre à jour le DUERP pour chaque nouvelle mission extérieure.
Mettre en place une procédure d’alerte interne
Informer les salariés de leur droit à signaler toute non-conformité, sans toutefois leur transférer la responsabilité du contrôle.
Prévoir une réponse hiérarchique rapide (suspension de la mission, fourniture d’un équipement mobile, modification du planning).
Besoin d'un soutien juridique en entreprise ? Consultez un avocat en droit du travail à Versailles pour vous épauler dans vos démarches de conformité.
Droits et devoirs des salariés
Le droit à un environnement conforme pour le salarié
Tout salarié bénéficie :
du droit de retrait (art. L 4131-1) en cas de danger grave et imminent ;
du maintien de sa rémunération lorsque le retrait est légitime ;
d’une protection contre les mesures disciplinaires liées à l’exercice de ce droit (art. L 4131-3).
Le devoir de coopération
Bien que la charge principale pèse sur l’employeur, le salarié doit :
respecter les consignes de sécurité et utiliser correctement les équipements mis à disposition (art. L 4122-1) ;
informer sans délai l’employeur de toute défaillance constatée, dans un souci de prévention partagée.
Risques juridiques et financiers en cas de manquement à la sécurité
Nature du risque | Fondement juridique | Conséquence possible |
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité | Art. L 4121-1 + Cass. soc. 11 juin 2025 | Condamnation proportionnée au préjudice (souvent 3 à 12 mois de salaire) |
Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur | Cass. soc. 11 juin 2025 | Indemnités équivalentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse |
Annulation du licenciement pour inaptitude | Cass. soc. 17 oct. 2012, n° 11-18.648 | Réintégration ou indemnités majorées |
Amende pénale pour infraction à la réglementation santé-sécurité | Art. L 4741-1 | Jusqu’à 10 000 € par infraction, multipliée par le nombre de salariés concernés |
Feuille de route opérationnelle pour un respect effectif de la sécurité au travail
Étape 1 – Cartographier les missions externes
Identifier les postes « nomades » : chauffeurs-livreurs, techniciens d’installation, consultants.
Recenser les risques spécifiques de chaque client.
Étape 2 – Formaliser un protocole de vérification
Liste de contrôle des équipements exigés par le médecin (ex. chariot électrique, siège ergonomique).
Fréquence des contrôles : initiale + audits trimestriels.
Étape 3 – Former les managers de proximité
Les rendre capables de bloquer la mission si une non-conformité est détectée.
Mettre à disposition une ligne directe avec le service santé au travail.
Étape 4 – Assurer une traçabilité exhaustive
Conserver les courriels, PV de réunion et rapports photos.
Faciliter la preuve en cas de contentieux prud’homal.
En consacrant l’obligation pour l’employeur de veiller lui-même à la conformité des lieux d’exécution situés chez un client, l’arrêt du 11 juin 2025 impose un changement de paradigme : la sous-traitance géographique ne dilue plus la responsabilité en matière de santé-sécurité.
Les dirigeants et DRH doivent intégrer cette exigence dans leurs process de vente, de planification et de prévention.
Côté salarié, le message est clair : la protection de la santé prime, et l’inaptitude ne saurait être imputée à un défaut d’organisation patronale. En anticipant, en documentant et en formant, l’entreprise réduit son exposition juridique tout en consolidant sa culture de prévention.